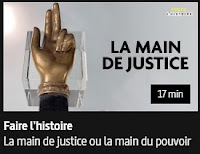Arte diffusera le 2 avril 2022 à 18 h 15, dans le cadre de « Faire l'histoire » (Faire l'histoire), « La main de justice ou la main du pouvoir » (Geschichte schreiben Die Hand der Justiz - Symbol der Macht) de Philippe Béziat. Dès le Moyen-âge, la main de justice, considérée comme un sceptre du roi David, dotée d'un sens religieux, est remise au roi de France lors de son sacre.
« Proposé par Patrick Boucheron, le magazine qui aborde l'histoire par le prisme des objets. Dans ce numéro : à partir de quand les objets deviennent-ils des symboles ? Entre effigie iconographique et simple bâton de commandement, voici la "main de justice" des rois capétiens du Moyen Âge. »
Le héraldiste Hervé Pinoteau a retracé l'histoire de la main de justice, dénommée au XVIIe siècle la main de Charlemagne (742, 747 ou 748-814). La main de justice remonte à la fin des Capétiens ou aux premiers Valois. Dès l'empereur d'Occident et roi des Francs Charlemagne, le monarque français est comparé au roi David de la Bible hébraïque. Se fondant sur un sens erroné de David (« main forte ») selon Saint-Jérôme, la main de justice aurait été considérée être un sceptre davidique.
« Second sceptre au moment du rituel du sacre royal, la main de justice apparaît au XIIIe siècle comme une effigie insigne, qui manifeste précisément que le roi ne juge plus, mais délègue, par sa main, la justice à des tribunaux et cours souveraines, qui vont faire du droit la base du pouvoir. Et inversement... »
C'est en 1461 lors des obsèques de Charles VII dit « le Victorieux » ou « le Bien Servi » que l'expression apparaît.
Fixée à l'extrémité d'un bâton ou sceptre, la main de justice, souvent en ivoire, a un sens religieux : le pouce représente le roi, l'index la raison, le majeur la charité - tous trois incarnent la Trinité divine -, et les deux derniers doigts, l'annulaire et l'auriculaire, repliés la foi catholique.
Un des symboles du pouvoir judiciaire, la main de justice a été peinte dans certains tableaux, notamment dans le portrait de Louis XV attribué à Henri Testelin. Elle est liée au sacre du roi. Conservée à l'abbaye royale de Saint-Denis, la main de justice était mise, après le sceptre, dans la main gauche du roi lors de la cérémonie de son sacre. Une autre était donnée à la reine pendant son sacre.
Signifiant que le souverain peut rendre la justice, cet objet précieux a aussi été reprise notamment par les rois de Navarre et d'Écosse au XVIe siècle, l'empereur Napoléon Ier, les empereurs du Brésil au XIXe siècle, les rois des Belges dès1830, Louis-Philippe roi des Français...
La main de justice est présente sur le faisceau de pique du Sénat, ainsi que sur les insignes ("baromètres") des parlementaires de la IIIe République.
« Avec Élisabeth Schmit, historienne de la justice médiévale », chercheuse postdoctorale au Collège de France, et dont le sujet de thèse est : "En bon trayn de justice" : les grands jours du parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans (1454-1459)."
"Ma thèse portait sur les Grands Jours, qui étaient des tribunaux éphémères, temporairement détachés du parlement de Paris dans plusieurs villes du royaume. Le Parlement était au Moyen Âge la plus haute cour de justice du royaume, qui jugeait notamment les appels en dernier ressort. Les Grands Jours permettaient donc, juste après la guerre de Cent Ans, de relancer et d’accélérer le cours de la justice après une période de crise. Ils s’inscrivent dans la relation très forte qui existe au Moyen Âge entre justice et paix. Au lendemain de ce long conflit avec l’Angleterre au XVe siècle, ils témoignent d’une forte volonté de restauration des institutions judiciaires. En étudiant les Grands Jours à partir des registres de ces sessions judiciaires, qui ont été conservés, j’ai donc cherché à comprendre le fonctionnement concret de la justice royale, mais aussi ce qu’on pourrait appeler la « politique judiciaire » de la royauté, c’est-à-dire les raisons politiques pour lesquelles on prête tant d’attention à la bonne marche de la justice" a déclaré Élisabeth Schmit le 3 mai 2021.
Et elle a ajouté : "Mes recherches actuelles portent sur la question de la procuration en justice. Le roi médiéval est un roi justicier : c’est lui qui est source de toute justice. On s’est beaucoup intéressé au fait que les juges rendent la justice au nom du roi, qu’ils le représentent. Mais on connaît bien moins le mécanisme de représentation des justiciables par les procureurs. Or il y a un phénomène intéressant : au Parlement, au début du XIVe siècle, seuls quelques privilégiés se font représenter par un procureur, c’est-à-dire par un professionnel qui s’occupe de toutes les démarches attenantes au procès, comme obtenir et faire produire les pièces nécessaires, gérer les relations avec l’avocat, etc. Un siècle plus tard, tous les justiciables, presque sans exception, sont représentés par un procureur. Ce changement s’explique, entre autres, par le fait que la procédure se complexifie beaucoup à la fin du Moyen Âge, et que la bonne marche d’un procès nécessite donc le recours à des professionnels. Mais ce qui est frappant, c’est que les procès et jugements sont restitués et enregistrés dans les archives comme si le roi et les justiciables étaient présents et s’exprimaient en leur propre nom : c’est une fiction, car il n’y a que des juges qui rendent des décisions devant des procureurs et des avocats. C’est la mise en place et la raison d’être de cette fiction qui m’intéressent. Je travaille sur ce projet en tant qu’attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au Collège de France. Mon temps se partage entre ma recherche personnelle et les activités de la chaire du Pr Patrick Boucheron, à laquelle je suis rattachée. Dans ce cadre, je m’occupe de la revue en ligne Entre-Temps, qui s’intéresse à toutes les formes d’écriture, d’enseignement et de transmission de l’histoire".
« La main de justice ou la main du pouvoir » de Philippe Béziat
France, 2020, 17 min
Sur Arte le 2 avril 2022 à 18 h 15
Disponible du 26/03/2022 au 03/01/2026
Visuels :
Main de justice
Élisabeth Schmit
© Les Films d' Ici
Articles sur ce blog concernant :




.jpg)
.jpg)